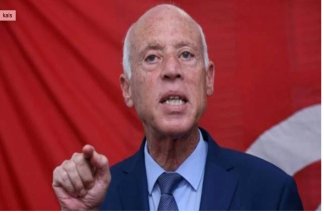International
Washington–Tel-Aviv : vers la rupture ? Le prix stratégique de l’après-Gaza – Par Biala Talidi

Benyamin Netanyahu à la Maison Blanche avec Donald Trump – La déclaration d’Itamar Ben Gvir, selon laquelle « Israël doit désormais compter sur elle-même », en dit long sur la rupture qui se dessine.
La fracture entre les États-Unis et Israël semble s’élargir au fil des divergences sur la guerre à Gaza, les négociations régionales et la stratégie face à l’Iran. Bilal Talidi estime que di l’administration Trump entend apaiser les tensions pour sauver le processus de normalisation, Tel-Aviv, de son côté, semble préférer l’escalade pour préserver l’avenir politique de Benyamin Netanyahou. Au cœur de cette discorde : la fin possible d’une ère d’alignement inconditionnel.
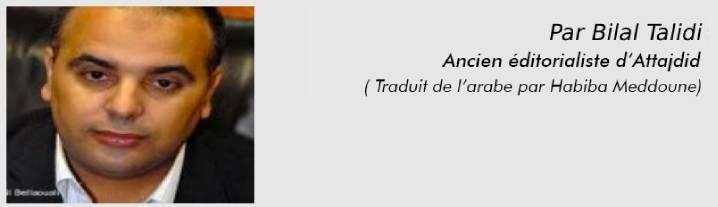
Plusieurs signaux consécutifs indiquent que le point de rupture entre l’administration de la Maison Blanche et le gouvernement de Benyamin Netanyahou est devenu imminent, et ce, malgré l’enthousiasme de l’extrême droite israélienne à la suite de la victoire du président américain Donald Trump à l’élection présidentielle, ainsi que les déclarations répétées évoquant une convergence de vues sur le déplacement des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï, et le soutien à la guerre israélienne contre Gaza, y compris la politique de blocus, de famine et d’extermination.
Accords bloqués, divergences affichées
La divergence s’est amplifiée au moment où Tel-Aviv a choisi de se rétracter de l’accord conclu avec le Hamas, refusant d’en appliquer les dispositions prévues dans la deuxième phase, et même de s’engager dans une quelconque négociation concernant ses obligations. Cette phase portait notamment sur un retrait israélien complet de la bande de Gaza, la levée du blocus, et l’acheminement de toutes les formes d’aide humanitaire, en échange d’une libération totale des prisonniers et détenus aux mains des factions palestiniennes.
En réalité, l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a tenté de masquer cette divergence en accusant le Hamas d’avoir rejeté sa nouvelle proposition. Or, cette dernière n’était en fait qu’un projet alternatif annulant l’accord précédent, puisqu’elle reprenait l’agenda israélien consistant à prolonger la première phase (l’échange de prisonniers) sans que Tel-Aviv ne s’engage sur les obligations de la seconde, notamment le retrait de Gaza.
Mais cette tentative de dissimulation du désaccord n’a pas suffi à masquer le manque d’harmonie entre Washington et Tel-Aviv. Le différend a rapidement éclaté au grand jour après que les États-Unis ont annoncé l’ouverture de discussions directes à Doha avec des dirigeants du Hamas, par l’intermédiaire d’Adam Boehler, envoyé spécial du président Donald Trump chargé du dossier des prisonniers. Ces pourparlers ont abouti à des résultats très prometteurs — notamment l’acceptation du Hamas — avant que la pression israélienne ne contraigne Trump à geler ce processus, et à revenir à l’option de la médiation indirecte, menée par Steve Witkoff, en coordination avec Le Caire et Doha.
Pour satisfaire Tel-Aviv, Washington a même dû faire fuiter, par des responsables américains, de fausses informations à la presse, prétendant qu’Adam Boehler avait terminé sa mission, et que la seule voie de médiation entre Israël et le Hamas passait désormais par Steve Witkoff, en collaboration avec les médiateurs égyptiens et qataris.
Le signe révélateur de la divergence entre Israël et les États-Unis a émergé avec la visite de Benyamin Netanyahou à la Maison Blanche. Une visite au cours de laquelle Tel-Aviv espérait voir une convergence de vues avec Washington en faveur d’une frappe militaire surprise contre le programme nucléaire iranien. Mais la délégation israélienne a été confrontée à deux positions américaines embarrassantes : la première, la volonté des États-Unis de négocier avec Téhéran sans inclure les questions des axes régionaux dans l’agenda des discussions ; la seconde, un sévère reproche adressé à Israël concernant ses frappes non coordonnées en Syrie et les risques qu’elles pourraient engendrer — notamment un affrontement militaire avec la Turquie dans le sud syrien. Washington a ainsi invité Israël à engager un dialogue avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le gratifiant au passage de nombreux éloges pour son rôle joué en Syrie.
L’accord avec les Houthis, une ligne rouge franchie
Le tournant décisif est survenu lorsque Washington est entrée dans des négociations indirectes avec les Houthis, aboutissant à un accord sous médiation omanaise pour mettre fin aux frappes réciproques. Cependant, les Houthis n’ont pas été contraints de cesser leurs attaques contre Israël et ses navires commerciaux en mer Rouge et en mer d’Arabie. Ce que Tel-Aviv a interprété comme un désengagement américain de la défense d’Israël, et comme une manœuvre unilatérale de Washington pour préserver ses propres intérêts, au détriment de ceux d’Israël. C’est ce qui explique sans doute la déclaration du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, selon laquelle « Israël doit désormais compter sur elle-même ».
Le président américain Donald Trump effectuera, du 13 au 16 mai, une tournée au Moyen-Orient, qui le conduira en Israël, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Cette visite devrait être précédée d’une annonce importante dont les détails n’ont pas encore été révélés. Mais tout porte à croire qu’elle portera sur la fin de la guerre à Gaza et la signature d'accords d’investissement massifs avec les pays riverains du Golfe. Le message de Trump au monde arabe à travers cette tournée repose, selon l’analyse américaine, sur deux promesses : d’une part, la garantie de la fin de la menace iranienne dans la région à travers un accord nucléaire négocié avec Téhéran sous médiation omanaise ; d’autre part, la fin de la guerre à Gaza et le retour à la situation d’avant-guerre, en capitalisant sur les acquis du processus de normalisation.
En réalité, il s’agit de bien plus qu’une simple gestion d’intérêts privés par Washington en marge de sa relation avec Tel-Aviv. L’alignement tactique entre les deux capitales autour du projet de déplacement des Palestiniens de Gaza et la transformation de l’enclave en projet immobilier et touristique ambitieux touche à sa fin. Cela, en raison du refus de la résistance palestinienne de céder à l’exigence de libération des otages sans contrepartie — à savoir la fin de la guerre, le retrait total d’Israël de Gaza, la levée du blocus et la reconstruction —, ramenant ainsi le conflit à son point de départ : la fameuse question du « lendemain » selon la terminologie israélienne. Tel-Aviv n’a aucune vision viable pour l’avenir de Gaza, sinon des options agressives et insensées fondées sur la faim, la soif, et l’anéantissement de toute forme de vie, dans le but de forcer les habitants à l’exil et les factions à la capitulation. Jusqu’à présent, la résistance continue d’entraver ce plan par une ténacité accrue.
L’explication à laquelle nous adhérons est que le fossé entre Washington et Tel-Aviv a atteint un point de non-retour, en raison du comportement de cette dernière, qui agit désormais sans la moindre vision stratégique, ni pour ses propres intérêts, ni pour ceux de son allié américain. Son comportement agressif, ses frappes militaires unilatérales contre plusieurs pays (notamment au Liban, en violation de l’accord de cessez-le-feu, et en Syrie), ainsi que ses projets d’attaque contre le programme nucléaire iranien, montrent que sa direction agit davantage sous l’impulsion de sa survie politique que selon des calculs stratégiques rationnels.
Le fardeau Netanyahou, obstacle à la normalisation
Washington est désormais convaincue que la préservation de ses intérêts dans la région passe par la réussite des négociations avec l’Iran, la poursuite de l’accord avec les Houthis, la fin de la guerre à Gaza, et l’arrêt par Tel-Aviv de ses attaques contre le Liban et la Syrie. Israël, au contraire, considère que s’aligner sur ces priorités américaines signerait la fin du gouvernement Netanyahou — voire de la carrière politique de son Premier ministre. C’est pourquoi Tel-Aviv cherche à attiser les tensions et les conflits dans la région pour forcer Washington à revenir à la table des compromis. Faute de quoi, tous les fils du dossier moyen-oriental risquent de se rompre et Washington perdrait sa capacité à gérer simultanément tous ces fronts.
Actuellement, Tel-Aviv est dans une position de faiblesse croissante : militairement (manque de préparation des réservistes), économiquement (coût élevé de l’extension de l’opération militaire), politiquement (pression grandissante de l’opposition et de la rue israélienne), stratégiquement (absence de vision claire pour l’après-Gaza), et régionalement (frustration croissante du monde arabe envers la politique de Netanyahou et son atteinte aux acquis historiques de Camp David et de Wadi Araba). De son côté, Washington poursuit un seul objectif : désamorcer les tensions, mettre fin aux guerres, et créer les conditions d’une reprise du processus de normalisation. Un objectif irréalisable sans la chute du gouvernement de Benyamin Netanyahou.
Tout porte à croire que l’échec du projet de déplacement des Gazaouis par la résistance palestinienne, le rejet de ce plan par plusieurs États arabes, et l’escalade aveugle menée par Tel-Aviv sans vision d’avenir, ont convaincu Washington de l’impossibilité d’atteindre ses objectifs stratégiques — qu’il s’agisse de servir les intérêts d’Israël ou de consolider ses propres partenariats économiques avec les pays du Golfe — tant que Benyamin Netanyahou reste au pouvoir. En somme, l’obstacle principal à la réussite du processus de normalisation, tel qu’envisagé par les États-Unis, n’est autre que le Premier ministre israélien lui-même. Et pour faire avancer ce processus, il faudra, selon Washington, sacrifier l’avenir politique de Benyamin Netanyahou.