chroniques
III - Le mea culpa de Abdejlil Lahjomri … Les nouvelles heures françaises du Royaume

Dans la première partie du Mea-culpa, Abedjlil Lahjomri montre « l’évolution de la présence du Maroc dans l’actualité littéraire française […] qui, dès ses premières apparitions, hantait les personnages et leurs créateurs comme un pays de légende, de rêves inquiétant ou bienfaisants, se retrouve aussi dans des écrits, à l’instar d’Un Aller-simple, comme légende, rêve ou cauchemar. » Dans la deuxième partie, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume la mutation des personnages de cette littérature où le Maroc devient l’instance narrative et acquiert une dimension autrement symbolique, puisque la distance entre l’Autre et soi-même est abolie, abolition qui mène à une confluence insolite, inconfortable. Il s’y est aussi intéressé à ce qu’il aurait choisi de traduire des récits qu’ils offrent. Dans cette troisième et dernière partie, il se demande, et y répond, pourquoi en fait traduire ? On y croise une singulière nostalgie du présent et le regret de ne pas y retrouver « notre Désert, notre Marche » narrés en arabe avec une la si belle simplicité de Le Clézio :
Je me suis intéressé uniquement au récit de cette marche à ces pages que j’aurais traduites, parce que la langue arabe, langue née du désert m’aurait offert autant de mots justes, uniques, et irremplaçables que la langue française pour évoquer la lumière, la chaleur émanant des pierres, la couleur des remparts, l’espérance des hommes, la dimension spirituelle des dignités adultes et enfantines.
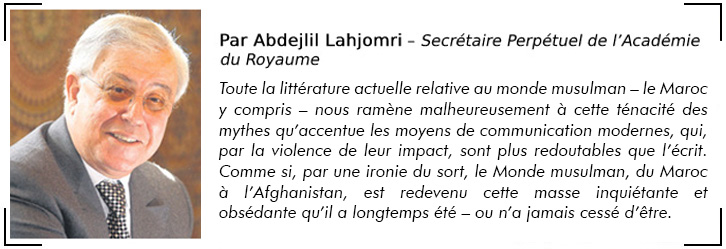
Mais, en fait, pourquoi traduite ? N’y aurait-il pas un écrivain de langue arabe susceptible, avec la même réussite que celle de Le Clézio, de choisir le désert, et d’en faire le personnage central de son roman parce qu’à travers les âges, le désert est éternel, qu’il est le fondateur de notre être et que l’épopée saharienne, que notre génération a vécue avec passion, a été le plus beau des rendez-vous, le rendez-vous d’avec nous-mêmes ? Cet auteur nous ferait revivre cette autre marche vers notre Désert qui, du nord au sud, mobilise toutes nos espérances.
Comme Lalla, nous aussi sommes retournés vers notre Désert, et ne le quitterons plus jamais.
Certes, pourquoi traduire ? Aucune raison de faire, pour ainsi dire, l’économie d’« une langue étrangère » qui parle avec tant de pureté d’un espace qui lui est étranger. Si un romancier de langue arabe pouvait ainsi envoûter le lecteur en parlant de notre Désert, de notre Marche avec une si belle simplicité – et la langue arabe le lui permet par son effervescente modernité – il y aurait là enrichissement de notre patrimoine créatif et le débat linguistique s’en trouverait sinon apaisé, du moins ouvert à toutes les promesses.
Le Clézio, serait-il un écrivain français, d’inspiration maghrébine ? Avec le succès récent de Poisson d’or, on peut légitimement s’interroger sur cette présence essentielle de l’environnement marocaine dans l’ensemble de ses écrits. Dans ce nouveau roman, on retrouve les mêmes thèmes que dans Désert, le désert en moins, la même évocation de la condition de la femme marocaine, musulmane, courageuse et noble, malgré la modestie de ses origines et de sa quotidienneté.
Trois œuvres : Désert, Printemps, Poisson d’or, trois femmes marocaines : Lalla, Saba, Laïla, d’une ténacité, d’une timidité qui forcent l’admiration et nous autorisent à nous demander si Jean-Marie-Gustave Le Clézio n’a pas prêté son art aux contes et légendes de son épouse marocaine.
Avec Didier Van Cauwelaert, c’est l’Orient qui devient français, puisque l’immigré s’approprie l’identité et la nationalité du personnage français qui l’accompagne. Avec Le Clézio, c’est la France qui devient orientale, parce qu’à l’instar de François Bonjean, il s’approprie la mémoire de son épouse, et par cette appropriation, c’est le cœur sensible de Jemaâ qui vibre aux souvenirs de son enfance. La substitution est poussée à un tel degré de confluence que ces romans se parent des qualités de l’autobiographie et donnent l’impression de surgir de l’âme marocaine et la récente publication des Gens des nuages confirme une si bouleversante confluence.
Lisez Désert, Printemps et lisez Poisson d’or, vous y découvrirez ce qu’est pour J.M.G. Le Clézio la femme marocaine comme elle l’a été par François Bonjean. Courageuse, exigeante, ne goûtant la paix que quand elle retrouve sa terre natale et nourricière, son Désert, notre espace de liberté et d’amour. Nous sommes loin, très loin des orientales que nous avons rencontrées dans la plupart des précédents récits.
Le lecteur peut toujours continuer ainsi à pister la présence du Maroc dans toute production nouvelle dans les lettres françaises. Il sera surpris, parfois amusé ; il rencontrera, par exemple, dans le nouveau roman de Pascal Bruckner les Voleurs de beauté, un personnage déterminant. Elle s’appelle le docteur Ayachi. Elle est « née du mariage d’un père marocaine de Rabat et d’une mère wallonne, (…), une plante qui puise aux deux rives de la Méditerranée, (qui) délaisse Louise Labé pour lire les Mille et une nuits, n’a jamais souffert d’être écartelée entre le Maroc et la Belgique, (…), chant des brides de mélodies arabo-musulmanes ». Elle aime le chanteur égyptien Farid El Atrache, se promet chaque année d’apprendre l’arabe en hommage à son père ».
Il sera souvent intrigué de voir continuer à être disséminée ici ou là, au hasard des publications, la même imagerie que celle que nous avons rencontrée dans l’ensemble de nos précédentes lectures, de Pierre Loti jusqu’à Henry de Montherlant.
Non que ces affirmations reflètent les croyances ou les convictions des auteurs eux-mêmes mais, parce qu’elles sont simplement révélatrices de leur pérennité, de leur ténacité dans l’inconscient collectif. Comme, par exemple, ce qu’avance un personnage de ce même roman. « Les musulmans ont bien raison de voiler leurs femmes, de les claquemurer. Ils savent eux que l’apparence n’est pas innocente. Ils ont juste le tort de ne pas distinguer entre les visages magnifiques et les autres et surtout de ne pas enfermer les jolis garçons, tout aussi nocifs ». Ce type de propos nous renvoie à l’ambivalence de l’image qui a été le point de départ de toute cette étude : une fascination pour un monde proche et, en même temps, la persistance d’une mythologie réductrice trompeuse.
Toute la littérature actuelle relative au monde musulman – le Maroc y compris – nous ramène malheureusement à cette ténacité des mythes qu’accentue les moyens de communication modernes, qui, par la violence de leur impact, sont plus redoutables que l’écrit. Comme si, par une ironie du sort, le Monde musulman, du Maroc à l’Afghanistan, est redevenu cette masse inquiétante et obsédante qu’il a longtemps été – ou n’a jamais cessé d’être.
Nombreux sont les exemples qui illustrent cette ténacité du mythe et la persistance de l’ambivalence de l’image. Comme si, par une ironie de l’histoire – et l’histoire ne se répétant pas – tout semble avoir changé et tout semble n’avoir pas changé. Tout semble avoir évolué vers un effritement des mythes, tout semble évoluer vers leur nuisible consolidation.
Au regard de l’Autre, quel serait à l’avenir notre image ? Quelle image offrirons-nous de nous-mêmes ? Car tout maintenant est une affaire de représentation, et toute survie une affaire d’image et d’imagination.





















