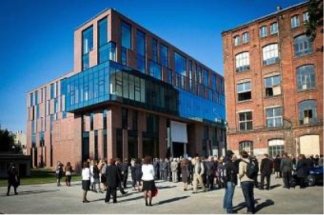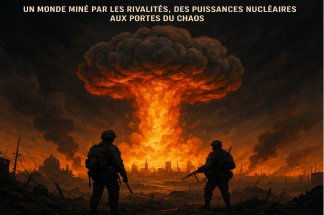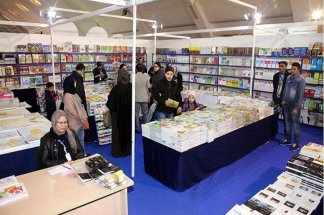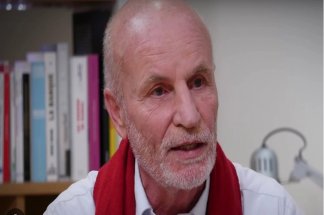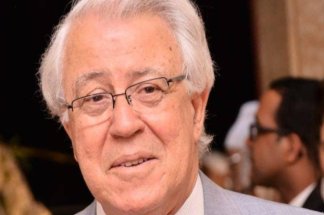chroniques
Un nouveau paradigme pour la politique africaine du Maroc : Doctrine, institutions et alliances – Par Adnan Debbarh

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita

L’échec du Maroc lors de l’élection du vice-président de la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba en 2025 est un avertissement. Il révèle une faiblesse structurelle : un dispositif diplomatique qui peine à transformer son activisme en influence institutionnelle durable. Il ne s'agit ni d'un simple accident de parcours, ni d'un faux pas isolé, mais bien du symptôme d'une diplomatie qui doit impérativement franchir un cap décisif.
Depuis son retour au sein de l’UA en 2017, le Maroc a déployé un activisme diplomatique remarquable, alignant sommets, accords économiques et projets structurants. Mais les limites d’une approche centrée sur des coups d’éclat apparaissent aujourd’hui au grand jour. La séduction et la communication ne suffisent pas, l’influence durable se construit par une présence continue, un ancrage institutionnel et un travail patient dans les rouages du pouvoir africain.
L’épisode d'Addis-Abeba a mis en évidence cette faiblesse structurelle. Le Maroc s’est trouvé dépourvu face à une Algérie qui, bien que fragilisée sur le plan intérieur, conserve une capacité de nuisance diplomatique intacte. Son travail de sape, loin d’être improvisé, s’appuie sur des réseaux entretenus de longue date, un activisme constant au sein des instances africaines et une habileté à jouer sur les divisions et les ambiguïtés. Réduire cet échec à la seule "diplomatie des valises" serait une illusion. Ce serait se bercer d’illusions et passer à côté de la véritable leçon à tirer : le Maroc n'a pas consolidé ses acquis.
L’action diplomatique marocaine a souvent reposé sur des moments de forte intensité, portés par des tournées royales spectaculaires. Ces initiatives ont créé un capital de sympathie réel et ont déclenché des dynamiques économiques prometteuses. Mais elles n’ont pas été suivies d’un travail institutionnel de fond. L’exemple des 28 pays ayant soutenu le retour du Maroc à l’UA est éloquent : ce bloc diplomatique n'a pas été renforcé, ni transformé en une assise stable et fiable.
De même, l'absence d'un lobbying efficace au sein des commissions de l'Union africaine a laissé le champ libre à des manœuvres adverses. Trop souvent, Rabat a réagi au lieu d'anticiper. Cette incapacité à structurer un réseau diplomatique solide révèle une carence plus profonde : l’absence d’un cadre stratégique pérenne qui ancre le Maroc dans les équilibres africains.
Le Maroc doit rompre avec une diplomatie de conjoncture et s'inscrire dans une dynamique de consolidation durable.
Cela commence par la définition d’une doctrine diplomatique claire. Le Maroc ne peut plus se contenter d’une stratégie par ajustements successifs. Il doit formuler une vision structurée de son rôle en Afrique, qui ne se limite pas à la question du Sahara, mais qui l’inscrive comme un acteur majeur de l’intégration économique et institutionnelle du continent.
Les investissements en Afrique, la consolidation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la structuration de corridors commerciaux et la promotion d’une politique panafricaine énergétique sont des axes stratégiques insuffisamment exploités.
La diplomatie doit aussi s’appuyer sur des institutions solides et ne pas reposer sur la seule action de quelques hommes.
Le ministère des Affaires étrangères fonctionne encore de manière trop verticale, freinant l’émergence d’un corps diplomatique proactif et bien implanté en Afrique. Une diplomatie efficace ne peut pas se limiter à quelques figures de premier plan, elle doit reposer sur un réseau actif, des alliances informelles, des relais parlementaires, des présences économiques stratégiques. Aujourd’hui encore, le Maroc manque cruellement de diplomates influents siégeant dans les organes clés de l’Union africaine.
Il faut enfin revoir le mode de fonctionnement du lobbying marocain. Les désillusions diplomatiques répétées montrent que l’on ne peut pas uniquement compter sur des amitiés affichées. L'Égypte en a fourni une démonstration éloquente en retirant sa candidate pour mieux appuyer l’Algérie. Rabat doit abandonner toute forme de naïveté et multiplier les cercles d’influence.
L'une des dimensions essentielles qui reste à structurer est celle des alliances. Le Maroc doit renforcer ses relations stratégiques avec des puissances africaines telles que le Nigéria, le Kenya et l'Afrique du Sud qui jouent un rôle central dans leurs sous-régions respectives. Ces pays sont des partenaires-clés pour impulser des dynamiques économiques et politiques. Dans un registre plus large, la France, la Turquie et la Chine sont des acteurs incontournables du jeu africain. Le Maroc doit positionner ses relations avec ces puissances de manière intelligente, en jouant sur des convergences d'intérêts sans tomber dans une dépendance excessive.
Il ne s'agit pas d'alignements passifs, mais d'une diplomatie d'équilibre qui maximise les opportunités sans sacrifier l'autonomie stratégique.
Le poids du Maroc en Afrique ne doit pas se mesurer uniquement à ses investissements, mais à sa capacité à peser sur les processus décisionnels. L’échec d'Addis-Abeba a au moins un mérite : il montre que le Maroc est à un tournant.
Soit il corrige ses failles structurelles et s’inscrit dans la durée, soit il reste prisonnier d'une diplomatie faite de pics d'activité sans consolidation.
Le Maroc a les moyens d’une diplomatie forte et influente, à condition d’en tirer les leçons et d’agir dès maintenant.
L’ambition doit être assortie d’une méthode et l’influence d’un ancrage stratégique.