Culture
Chronique des ''temps (presque) heureux''

En réalité je voulais intituler cette chronique ''Chronique au goût de fraise'' comme une épitaphe à un ami journaliste, décédé avant la pandémie, dans une solitude terriblement injuste, oubliée, comme s’est éteinte, solitaire, Aicha Mekki dont j’ai pleuré les chroniques égarées. Les journalistes sont-ils condamnés à mourir, ainsi, sans épitaphe comme meurent de nos jours toutes les innocentes victimes de ce virus dévastateur et déroutant ? Je prends toutefois la liberté ( le lecteur bienveillant m’en excusera ) d’ouvrir une parenthèse et de profiter du douloureux souvenir de Aicha Mekki pour signaler à mon ami Salim Jay, ( mais se rappellerait-il vraiment de nos déambulations dans Rabat des temps heureux), que ce confinement m’a permis dans ma relecture de son « Dictionnaire des écrivains marocains » de découvrir que s’est glissée, surement à son insu, à propos de la publication des chroniques de notre regrettée Aicha Mekki), une étonnante, inamicale et quelque peu désobligeante indélicatesse à mon égard. Je l’invite avant de revenir à mon propos à relire ce récit qu’il présente ainsi « L’unique ouvrage, hélas posthume, d’Aicha Mekki « Pleure Aicha tes chroniques égarées » ( Editions Malika ) possède cette singularité que le nom de son auteur ne figure nulle part en couverture ». Il découvrira qu’il se trouve, hélas, que Aicha Mekki n’a jamais écrit d’ouvrage. Et que ce titre est de mon invention. J’invite Salim Jay, s’il est encore confiné de me faire l’amabilité de consacrer un moment à sa méprise, et relire ce récit romancé un peu plus attentivement pour excuser mon étonnement devant ce curieux manquement à la déontologie qui s’impose à tout critique et qu’il s’est toujours imposé à lui-même dans sa lecture des auteurs de langue française ou de langue arabe figurant dans son dictionnaire et qu’il a présentés si brillamment et si judicieusement comme il le fait toujours dans ses écrits critiques, avec la remarquable maîtrise de la langue française que nous lui connaissons .
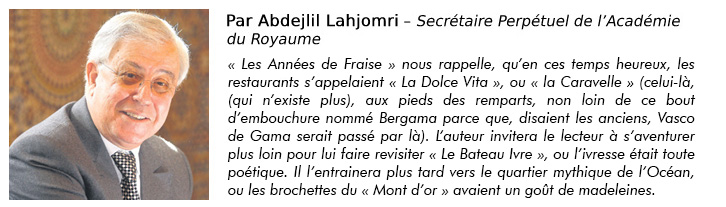
Voilà que je me suis éloigné du sujet de ma chronique des « temps (presque) heureux » qu’a ressuscités le malheureux Noredine Ben Mansour dans son délicieux récit intitulé « Les Années de Fraise ». Il en est ainsi en ces temps incertains que les lectures sont disparates et l’écriture aussi. Je voulais, au début du confinement, partager avec vous le roman passionnant de Maria Duenas « L’espionne de Tanger », roman de plus de six cents pages que j’ai cru inspiré du « Tailleur de Panama » de John le Carré mais qui ne l’était pas. Cependant la présentation de ce livre, historiquement bien documenté, qui allie la vérité historique et l’imagination la plus puissante mériterait une étude plus fouillée, plus approfondie qu’une simple chronique.
Je voulais aussi comparer avec vous le roman de Hassan Aourid « Le Morisque » au récit de Mouna Hachim « Les Manuscrits perdus » qui traitent du même sujet, de la même époque des exils andalous, du même personnage « Ahmed Ibn Qassim Al-Hajari » surnommé Afoqay : les deux auteurs usant de la liberté que la création littéraire octroie généreusement à tout écrivain pour faire une biographie romancée de l’exilé andalou à partir de son ouvrage qui mériterait une analyse érudite intitulé « Kitab Nassir al-din Ala quawm al kafirine ». Mais cette comparaison aurait nécessité, elle aussi, une longue dissertation sur l’exil, les clôtures dogmatiques, l’intégration ou la désintégration des identités, sur la tolérance, les intégrismes, les intrigues politiques et les errances philosophiques. Peut-être que l’ouvrage de celle qui se présente et que l’on présente comme un écrivain « américano - marocain » Anissa M. Bouziane intitulé « Sables », aurait pu faire l’objet de cette chronique mais il était, encore une nouvelle fois, question d’identité. Et pour me consacrer encore une fois à un thème récurrent et apparemment inépuisable, j’aurais aimé n’être plus en confinement pour pouvoir éclaircir sereinement, pourquoi, comme l’avait déjà signalé A. Khatibi, la langue maternelle de ces écrivains « exilés » (l’arabe dialectal) envahit toujours leurs récits, les pénètre au point que, répétitive, elle irrite le critique fatigué par ce surgissement incontrôlé d’une langue oubliée de leur propre aveu, qui brouille son appréciation du récit au risque qu’il s’insurge et délaisse des romans juvéniles malgré tout captivants et prometteurs.

L’évocation des « Temps heureux » de Rabat par un journaliste amoureux de sa ville, militant anonyme de la défense et de l’illustration de l’esprit mystérieux de ses lieux dans leur adaptation à une modernité ardente et vigoureuse m’a paru un léger divertissement pardonnable par ces temps d’interrogations confinées. C’est que « Les Années de fraise » méritait au moins une chronique, comme modeste épitaphe à son auteur qui sauverait de l’oubli un ouvrage sans prétention, mais témoignage tout de même vrai d’une époque révolue, à jamais effacée de la mémoire d’une génération désabusée.
Il avait inventé le tweet avant le tweet. Il avait appelé ces quelques lignes « Télégrammes » et en quelques mots, il brossait le portrait d’un artiste, d’un politicien ou d’un anonyme, faisait part d’une rumeur, annonçait un évènement de toute sorte, un incident de tout genre, se réjouissait d’une bonne publication, s’indignait contre une injustice, murmurait une indiscrétion, se révoltait contre les abus. C’était pour beaucoup de lecteurs la première lecture du matin, (avant l’horoscope), qui distillait l’air du temps, donnait au jour sa tonalité en annonçant une saveur succulente ou une fadeur insipide.
« Les Années de Fraise » nous rappelle, qu’en ces temps heureux, les restaurants s’appelaient « La Dolce Vita », ou « la Caravelle » (celui-là, (qui n’existe plus), aux pieds des remparts, non loin de ce bout d’embouchure nommé Bergama parce que, disaient les anciens, Vasco de Gama serait passé par là). L’auteur invitera le lecteur à s’aventurer plus loin pour lui faire revisiter « Le Bateau Ivre », ou l’ivresse était toute poétique. Il l’entrainera plus tard vers le quartier mythique de l’Océan, ou les brochettes du « Mont d’or » avaient un goût de madeleines. On pouvait, dit-il, « sentir les fumées se dégager des cafés et assister au bal qui commençait (c’est qu’en ces temps « presque heureux », figurez-vous, il y avait des bals dans cet espace nocturne qui respectaient les règles de la vie nocturne). Il aurait pu aussi rappeler que chaque grande école, chaque faculté, avait son bal, le plus prisé étant celui de la faculté de médecine dont les enseignants avaient formé les médecins et le corps médical qui aujourd’hui avec courage, abnégation et civisme impressionnants sont au front de cette solidarité qui nous sauvera, grâce à leur admirable engagement, de cette tragique fatalité planétaire.
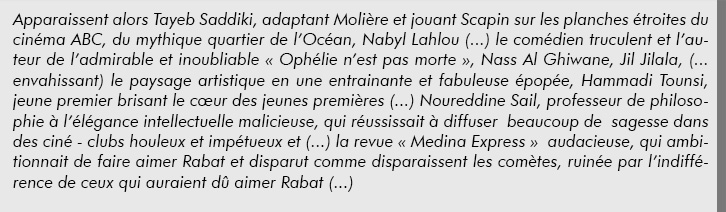
Les plus chanceux rencontraient Edith Piaf aux bras de son amant Marcel Cerdan au restaurant-bar chez « Mme Escobar », deux célébrités qui se promenaient tout au long de l’avenue « Marie - Feuillet » (maintenant avenue Abdelkrim al Khattabi) comme si elles étaient aux Champs Élysées parisiens. Et les plus intellectuels terminaient la soirée au restaurant « Le Mandarin » qu’un réfugié vietnamien gérait et qui leur contait comme une légende la geste de HO CHI MINH. L‘énigme, malgré tout, subsistait, car on n’a jamais su pourquoi un révolutionnaire avait choisi pour son restaurant un nom aussi « aristocratique » que celui de « mandarin ».
En ces temps-là, Rabat préfigurait déjà la ville-jardin qu’elle deviendra, qu’elle est et aspire à devenir dans un déploiement de verdure flamboyant. Mais en ces temps-là, surtout, ses jardins étaient aussi espaces de représentation et dans l’un d’entre eux, le jardin du « Triangle de vue », se donnaient dans un théâtre de plein air (maintenant délaissé) des spectacles qui parfois accueillaient des actrices aussi prestigieuses que l’était Maria Casares.
La lecture du texte « Les années de fraise » opère comme une thérapie. Dès que l’auteur évoque un incident (par exemple les altercations amicales de Tayeb Saddiki avec Nabyl Lahlou) un flot de souvenirs épars assaillent et submergent une mémoire que polluent « les fakes news » dispersés sur le net par des esprits malveillants et vengeurs.
Apparaissent alors Tayeb Saddiki, adaptant Molière et jouant Scapin sur les planches étroites du cinéma ABC, du mythique quartier de l’Océan, Nabyl Lahlou prêchant malheureusement dans le désert, lui, le comédien truculent et l’auteur de l’admirable et inoubliable « Ophélie n’est pas morte ».
Nass Al Ghiwane, Jil Jilala, surgissant brièvement dans les créations théâtrales de T. Saddiki avant d’envahir le paysage artistique en une entrainante et fabuleuse épopée, Hamid Tounsi, jeune premier brisant le cœur des jeunes premières, l’exigeant classique maître-es-musique, Ahmed Bidaoui refusant à Houcine Slaoui et Hajja Hamdaoui les ondes de la chaine de la radio nationale, Noureddine Sail, professeur de philosophie à l’élégance intellectuelle malicieuse, qui réussissait à diffuser beaucoup de sagesse dans des ciné - clubs houleux et impétueux et deux revues, la revue « Medina Express » audacieuse, qui ambitionnait de faire aimer Rabat et disparut comme disparaissent les comètes, ruinée par l’indifférence de ceux qui auraient dû aimer Rabat, et la revue « Souffles », soufflant un vent chaud qui s’engouffrera dans une impasse de rêveries politiquement irresponsables.
Si je continuai ainsi, intarissable et bavard, à vous entretenir dans cette chronique, de l’ouvrage de N. Ben Mansour « Les années de fraise », je vous priverai d’un divertissement pascalien qui vous fera oublier ce confinement qui ne semble guère éphémère et vous éloignera comme il m’a éloigné de la relecture de deux œuvres que m’a conseillées un érudit sourcilleux et docte : « Voyage autour de ma chambre » de Xavier de Maistre, et « Zéro et l’infini » d’Arthur Kostler
On me reprochera d’avoir élu l’ouvrage d’un homme qui s’est laissé dépérir dans « les paradis artificiels » et ils auraient raison ceux que cette chronique irriterait, mais l’homme n’est pas l’œuvre, qui une fois publiée lui échappe totalement. Et celle-là m’a fait revivre, en ces temps dérangés et agités, dans cet imprévisible confinement universel, le souvenir de temps ou nous étions « presque », « non », ou nous étions réellement heureux.





















