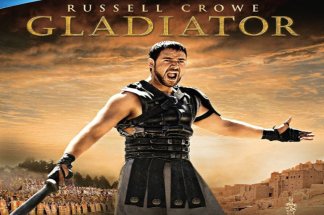Culture
L'Étuve existentialiste du Tabou. Juliette Greco, le dernier témoin…

Juliette Greco
Soirée dans l’atmosphère feutrée du Café Laurent, ancien refuge du mythique club de jazz Le Tabou. La contrebasse et le piano soutiennent moderato cantabile des swings roucoulés d’une voix éteinte. De vieux couples américains, affalés sur bas fauteuils, gesticulent romantiquement la cadence des standards familiers. Réminiscence d’une parenthèse historique. L’existentialisme dans la cave enfumée fermente, de jazz se suralimente, de phénoménologie s’argumente, de pataphysique se pimente, de libertinage s’assermente. Boris Vian, ensorceleur de la sulfureuse bacchanale, de son impertinente trompinette attise la flamme.
« Dans le train-train de la vie quotidienne, Boris Vian tire le signal de vacarme, et le train-train stoppe en pleine campagne, en plein ailleurs, en plein Paris » (Jacques Prévert). Anne-Marie Cazalis et Juliette Greco de leur pétillante insolence assurent la réclame. Raymond Queneau dans le tintamarre se déclame. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus… dans les vapeurs s’apostrophent et s’acclament. Artistes, poètes, philosophes, potaches et mirliflores s’amalgament. Le cauchemar de la guerre dans le rêve éveillé se volatilise. La liberté retrouvée dans la fête sans entraves se réalise.
Vie de bohème, rescapée des géhennes, où la poésie germine dans les scènes quotidiennes. Les génies désargentés fuient le froid des chambres de bonne pour se réchauffer toute la journée devant la même tasse de café, au Flore, aux Deux Magots, au Montana, à la Rhumerie, à la Reine Blanche avant de s’enivrer la nuit de notes bleues au Tabou. Des chefs d’œuvres se composent sur tables de bistrot. Les clochards eux-mêmes, barbe socratique, trompent leur faim en dévorant les dernières parutions philosophiques. L’hymne existentialiste est conçu un soir de beuverie au restaurant Le Catalan, rue des Grands-Augustins, quartier général de Pablo Picasso à proximité de son atelier, sur une musique de René Leibowitz avec un texte conjointement attribué à Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian et Anne-Marie Cazalis : « Je n’ai plus rien dans l’existence / Que cette essence qui me définit / Car l’existence précède l’essence / Et c’est pour ça que l’argent me fuit./ J’ai lu tous les livres de Jean-Paul Sartre / Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty / Mais c’est tout le temps le même désastre / Même pauvre tu es libre tu te choisis / J’ai bien essayé autre chose / Maurice Blanchot et Albert Camus / Absurde faux pas ! C’est la même chose / Tout n’est qu’un vaste malentendu / Demain Sisyphe, angoisse morale, Aminadab Nausée et compagnie / C’est tout le temps le même désastre / car même au Flore, plus de crédit ! ».
La mythologie du Tabou se construit en une année pour se perpétuer comme source d’inspiration de plusieurs générations. Boris Vian iconise le lieu dans une épitaphe décisive : « Très vite, le Tabou est devenu un centre de folie organisée. Aucun des clubs qui suivirent n'a pu recréer cette atmosphère incroyable. Le Tabou lui-même ne la conserva pas très longtemps. C'était d'ailleurs impossible ». Toute la légende tient dans l’occupation sous terre de l’espace-nuit, hors contrôle, hors surveillance, hors censure, hors malveillance légale. Hors horloges publiques. Le temps s’écoule comme un fleuve souterrain. L’esprit s’affranchit de ses souffrances au rythme des refrains. La misère matérielle se transcende dans l’audace transgressive. Le partage de la joie de vivre ignore les moralités castratrices et les acerbités délatrices. Les troglodytes se façonnent, dans le sillage des zazous, une manière d’être et de paraître. Les postures, photographes à l’affût, s’esthétisent. Les chemises à carreaux s’aristocratisent. Chaque soirée prolonge la veille. Le rituel se reprogramme au réveil.
La danse acrobatique se termine en transe initiatique. L’endurance s’énergise de fulgurances. L’intellection libératrice s’épanouit dans l’expression sensitive. Nul doute que Jean-Paul Sartre trouve dans ces plongées nocturnes une concrétisation vivante de ses idéalités cognitives.Il est récurrent dans l’histoire parisienne, depuis le Moyen Âge, qu’un quartier particulier, le Quartier Latin, le Marais, les Batignolles, Montmartre, Montparnasse… devienne un pôle d’attraction de l’intelligentsia d’une époque, inspire une émulation novatrice, insuffle une atmosphère propice au dépassement des références sacrales. Aux lendemains de la libération, le dernier âge d’or de la pensée prend corps à Saint-Germain-des-Prés, élisant Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir comme éclaireurs charismatiques. Une éblouissante antithèse du triomphalisme économique des trente Glorieuses et de l’abrutissement consumériste des intelligences.
Boris Vian dresse, dans son Manuel, un guide loufoque plus réaliste qu’une étude pointilleuse, une fascinante galerie d’artistes et d’écrivains atypiques, trempant leur plume désinvolte dans la fête permanente et l’interactivité pertinente. Tout d’abord, le diablotin caméléonesque toujours en avance sur une mode. « N’écartez aucun rideau, n’ouvrez nulle porte. Jean Cocteau est derrière. Il est chez lui dans ce Saint-Germain-des-Prés qui hait la mortelle somnolence des jours identiques ». Toute la truculence de l’auteur de L’Ecume des jours se retrouve dans la notice consacrée à son ami Raymond Queneau qui « n’occupe pas dans l’esprit du gros public le rang qu’il mérite, parce que Gallimard préfère vendre André Gide qui est, maintenant, trop vieux pour patienter, ou André Malraux qui lui fait du chantage chaque fois ». « Raymond Queneau est le seul écrivain qui ait à la fois un style, des idées et une langue uniques : c’est sans doute trop pour un seul homme. Gaston Gallimard préfère attendre que Raymond Queneau ait une grande barbe et un fauteuil à roulettes pour tirer ses livres à cent mille exemplaires et flanquer des grosses affiches partout ».
Alberto Giacometti, envoûteur envouté, perpétuellement taraudé par son perfectionnisme. « Tout le monde connaît sa chevelure touffue, son visage de cire un peu raviné, son allure vaguement hallucinée ». Jean Genet, débaucheur débauché, « fort spirituel quand il veut, il stigmatise un jour André Gide pour son immoralité douteuse ». Marcel Mouloudji, romancier, auteur dramatique, chanteur, acteur, peintre, est « de ceux qui prouvent, par l’exemple, qu’il y a dans le sixième arrondissement autre chose que des jeunes gens hâves, vêtus de chemises à carreaux, qui traînent leur démoralisation dans les caves d’où suinte le vice ». L’ombre tutélaire de certaines statues écrasantes éclipse cruellement la pudique luminosité de leurs descendants. « Comment voulez-vous qu’on s’en sorte quand on est le fils de François Mauriac ? Claude Mauriac aurait très bien pu devenir quelqu’un. Il lui suffisait de changer de nom ». L’écrivain égyptien Albert Cossery « cavale la souris que c’en est, une bénédiction » tandis que le saxophoniste américain, Miles Davis, « coureur impénitent, est facilement la proie du sexe faible pour lequel il a trop de faiblesse ». Alexandre Astruc, entre deux bitures, « se reconnaît volontiers un certain génie parent de ceux d’Orson Wells et Shakespeare réunis ». S’évoque incidemment l’éthique objectrice de conscience, dénonciatrice en toute circonstance de la logique punitive, teintée d’anticléricalisme bon enfant, inspiratrice du Déserteur, chanson interdite pendant les guerres coloniales. « On doit au bon sens rodésien la création d’un asile de fous dans lequel on s’empresse d’enfermer les écrivains comme Antonin Artaud qui souffrent de génie ». Beaucoup d’autres passent à la moulinette, avec justesse et délicatesse, et bien souvent avec tendresse. Il n’est que Maurice Merleau-Ponty, « tiers de la trinité existentialiste, le seul parmi les philosophes qui invite à danser les dames », qui suscite un peu de rancune « parce qu’il fait bougrement mal au crâne avec sa Phénoménologie de la perception ».
Quand Boris Vian se contente de dire de Jean-Paul Sartre « c’est un chic type », il dit tout sur le dernier Voltaire assommé des pires quolibets. « Le lancement de Saint-Germain-des-Prés n’est-il pas en grande partie dû au renom littéraire » de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, une marathonienne capable de parcourir « quarante kilomètres à pied dans la journée et d’enchaîner avec quarante heures de discussion quand la discussion l’intéresse ». Et pourtant, « les tôliers du coin n’ont jamais eu « trois sous d’honnêteté pour leur servir gratis leurs boissons ». Le portrait de Paul Boubal, inamovible parrain du quartier, , mérite à lui seul d’introduire les ontologies vaudevillesques. « Pour ne jamais quitter son établissement, même à l’heure des repas, le patron du Flore a acheté un appartement dans l’immeuble en pointe, à l’angle de la rue de Rennes et de la rue Gozelin. De là, avec un télescope et un radar, il peut surveiller sa caisse, ses garçons, sa terrasse... Il y avait un arbre sur sa ligne de mire. L’arbre est mort mystérieusement ». « Paul Boubal peut prêter cinq cent mille francs à l’un de ses anciens garçons qui veut se mettre à son compte, sans garantie, sans intérêts, sans rien en contrepartie, et puis, passer une nuit à chercher une bouteille de champagne vide parce qu’elle manque aux cadavres retrouvés ». « Un jour, chez Cheramy, un client casse un verre. Jacques Prévert s’exclame : Je suis sûr que Boubal l’a entendu du Flore. Faut dire que Boubal n’aime pas la casse ». Jean d’Halluin, directeur des éditions du Scorpion, publicateur de Boris Vian (Les Fourmis…), éleveur de scorpions vivants ramenés d’Egypte, est l’unique bénéficiaire du Prix littéraire du Flore, « le seul prix honnête de l’année, décerné par les auteurs du Scorpion au auteurs du Scorpion, et arrosé par le directeur du Scorpion »
Boris Vian décrit un micro-archipel dont « les bras de mer et les canaux ne sont pas colorés en bleu sur les cartes pour permettre aux chauffeurs de taxi de les franchir sans s’en apercevoir. L’eau se poursuit au-delà de ces chenaux et ne revêt une apparence solide qu’afin de mieux tromper son monde. On sait que rien n’est perfide comme l’eau. Nos indigènes, pénétrés de cet axiome, se gardent bien de la consommer pure ». Cette terre relativement plate, mais capricieusement volcanique, a vu surgir deux montagnes en forme d’églises et une proéminence étrange, appelée Faculté de médecine, où « des couvées entières de toubibs, ces dangereux volatiles, parents du toucan d’Australie, s’abritent dans des anfractuosités particulièrement adaptées à leur développement ». « Le sous-sol pullulent de grottes et de cavernes désignés sous le vocable « caves existentialistes ». En cette occurrence, l’existentialisme s’entend au sens littéral du concept comme un mode de vie allergique aux normes institutionnelles.
Les autochtones sont des choses vivantes, métronomiques, chosifiés par leur immuable routine et leurs bisbilles intestines. Le jour, ils s’oublient dans le travail. La nuit, le sommeil les plonge dans l’oubli. Quand les troglodytes, par leur tapage sur le trottoir, dérèglent leur régularité métronomique, ils les inondent de seaux d’eau. Inutile de s’attarder sur les pétaradants, les assimilés, les incursionnistes, les envahisseurs américains, suédois, britanniques, les touristes de toutes confections en quête d’un souvenir édénique. Seuls les troglodytes méritent l’attention des chroniqueurs, non point des « pisse copie », flatteurs des mentalités grégaires, tricoteurs de bobards, déverseurs de fiel, mais des mémorialistes soucieux des mutations culturelles.
En Mai 68, ma besace couve en permanence un opus de Boris Vian, grignoté entre deux jets de pavé. Qu’un malotru, un flic travesti par exemple, plonge sa main à la recherche d’une preuve confondante, il sera piqué par le scorpion qui s’y niche. Ses doigts paralysés ne pourront plus manier la gâchette et ma lecture sera sauve. Après les assemblées anachroniques, les manifestations réitérées comme des exercices de salubrité physique et une soupe à l’oignon au Pied de Cochon, je m’extraie de mon groupe, je m’éloigne des experts de l’incompréhensible et des théoriciens de l’imprévisible, pour reposer mes neurones en musique dans la cave du Tabou. Des beatniks américains en escale sur la route de Katmandou, des dandys indifférents aux remous de la société, quelques filles délurées exagérément maquillés, quelques vieux nostalgiques collés contre les murs sur des chaises bancales. Un certain Pablo, guevariste lunatique à moins qu’il ne soit un Black-Panther déguisé en amuseur public, officie aux platines. A plusieurs reprises, je m’endors, le front collé sur la table, la main sur le cahier où je griffonne mon journal et quelque projet de tract, Pablo me laisse me reposer tout mon soûl et réveille à son retour avec un bon café et une tartine beurrée.