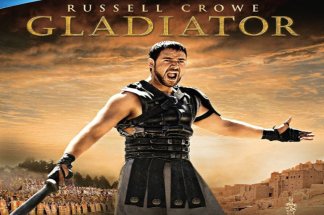Culture
Albert Memmi ou le malentendu (Par Mustapha Saha)

Je suis profondément attristé par la banalité et la pauvreté littéraire des hommages rendus à Albert Memmi. Les mêmes platitudes, les mêmes inexactitudes, se retrouvent quasiment dans tous les médias. J'ai travaillé récemment, pendant une année, avec Albert Memmi sur un projet de livre. Nous avons buté, à la fin, sur la question de son sionisme. Pendant plusieurs mois, il faisait une autocritique intéressante, corrigeant, avec humour, l'aveuglement d'une vie entière, qui s'explique par un conditionnement inculqué dès la prime enfance, un embrigadement dès l'école primaire.
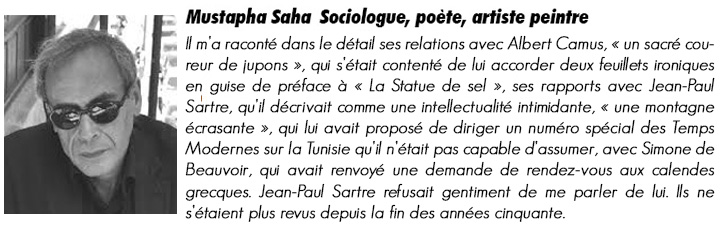
Il était finalement resté fidèle à son adhésion au mouvement de jeunesse Hachomer Hatsair, au risque de compromettre l’universalité de son œuvre. Il me parlait, avec drôlerie, de ses échanges avec Golda Meir. Cet indéfectible positionnement l'avait décroché de ses origines tunisiennes, distancié de sa maghrébinité. Il avait vite adopté, en tout cas dès son installation définitive en France, le regard du colonisateur qu'il avait si bien décrit et démystifié. Il pensait fortement que les arabes n’avaient d’autre chance de survie que l’adoption du modèle occidental et la laïcisation de leur islamité. Il revenait à la case départ, la mission civilisationnelle, hygiéniste, des colonisateurs. Il se voulait juif sioniste, citoyen français et tunisien paternaliste dans une personnalité qu’il savait douloureusement fragmentée. Jean-Paul Sartre avait bien souligné dans sa critique, devenue préface du « Portrait du colonisé », qu’Albert Memmi n’avait pas compris le colonialisme comme système, comme machine froide, comme négation absolue de l’altérité
Élisabeth et Mustapha Saha chez Albert Mimi
Je voulais réconcilier Albert Memmi avec le Maghreb, avec sa véritable appartenance ethnique et culturelle, avec le monde arabe, qui boycotte toujours ses livres. J’espérais voir ses ouvrages principaux, au-delà de tout clivage, enfin traduits en langue arabe. Entre déclarations explicites et sous-entendus lourds de significations, je le sentais confronté à une barrière insurmontable, une contrainte intime, une entrave invisible qu’il n’a jamais franchies. Albert Memmi aimait jouer au chat et à la souris. Il avait acquis, avec l’âge, une certaine sagesse et une malice certaine. Il éludait ses jugements et ses écrits injustes sur Jean Amrouche, qui fut son professeur au lycée Carnot de Tunis, sur Frantz Fanon, qu’il avait soigneusement évité de rencontrer, et sur quelques autres. Il liquidait Driss Chraïbi d’une formule assassine : « Il savait écrire, mais il avait un sale caractère ». Il m’a raconté dans le détail ses relations avec Albert Camus, « un sacré coureur de jupons », qui s’était contenté de lui accorder deux feuillets ironiques en guise de préface à « La Statue de sel », ses rapports avec Jean-Paul Sartre, qu’il décrivait comme une intellectualité intimidante, « une montagne écrasante », qui lui avait proposé de diriger un numéro spécial des Temps Modernes sur la Tunisie qu’il n’était pas capable d’assumer, avec Simone de Beauvoir, qui avait renvoyé une demande de rendez-vous aux calendes grecques. Jean-Paul Sartre refusait gentiment de me parler de lui. Ils ne s’étaient plus revus depuis la fin des années cinquante.
J’avais beaucoup d’affection pour Albert Memmi. Il me témoignait un attachement sincère en retour. J’ai fait sa connaissance à la faculté de Nanterre quand Alain Touraine, directeur du département de sociologie, l’avait sollicité, en 1970, pour un poste d’enseignant. Henri Lefebvre, qui était mon professeur principal, l’ignorait. Albert Memmi était, sans conteste un écrivain inspiré, auteur de quelques chefs-d’œuvre. Ses portraits du colonisateur et du colonisé étaient arrivés à point nommé, avaient joué un rôle important dans la lutte contre le colonialisme, à l’instar du « Discours sur le colonialisme » d’Aimé Césaire, qu’il avait croisé en septembre 1956, à Paris, au premier Congrès des écrivains et artistes noirs, sans suite. Albert Memmi refusait systématiquement que nous parlions philosophie. Il n’y avait que René Descartes qui trouvait grâce à ses yeux. Il n’était pas un sociologue à plein temps non plus. Il était un psycho-sociologue pragmatique. Il ne jurait que par les vertus des choses vues, observées, vécues. Un jour, il me dit : « Toute ma vie, je n'ai su faire qu'une seule chose, écrire. Je me donne l'appétit en lisant chaque jour un livre, en écornant quelques autres pour les besoins de la réflexion. Les références dessinent les pistes en pointillés. Et j'écris. La sève de l'écriture m'alimente et me nourrit".