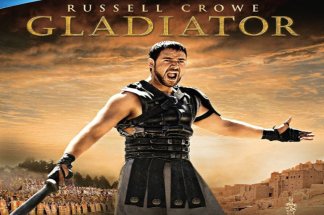Culture
Chella et la mystérieuse stèle funéraire de Abou Yacoub Youssouf le mérinide – l’integral

Chella et la mystérieuse stèle funéraire d’Abou Yacoub Youssouf le mérinide
5.jpg)
Cette chronique est la chronique d’une mystérieuse stèle funéraire, une légende à l’histoire aujourd’hui encore inachevée qui taraude depuis longtemps Abdejlil Lahjomri, attisant chaque jour un peu plus sa curiosité. Jusqu’à ce que le confinement survienne permettant enfin au Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume de s’y consacrer pour démonter les contours de cette stèle qu’un étrange orifice ce 12 cms de diamètre rend plus énigmatique encore. Cette chronique, le Quid l’a publiée en trois partie et en reprend ici l’intégral pour les amoureux des secrets de l’histoire.
Les mots ont leur magie, vous diront les amoureux des mots. Certains plus que d’autres.
De ceux-là émane un parfum de sacré, un mystère vertigineux. Ils demeurent, hantant notre enfance, énigmatiques. De plus, jadis, ils nous remplissaient de joie, quand nos mères, tournant le dos, (comme toutes les mères craintives de Rabat), à l’océan si proche le prononçaient avec émotion, nous entrainant hors de nos domiciles, dans un élan délicieusement fébrile, pour celles, en tout cas, dont le destin était d’être assujetties à un confinement consenti, retrouvant une liberté inattendue, rêvant d’une ivresse de réjouissances, en nous précipitant vers un des jardins de la ville, le plus chatoyant, le plus fleuri, le plus captivant par les légendes qui l’habitent. Ce mot, dans l’histoire tumultueuse de Rabat est le plus riche en effervescences tragiques, mouvementées. J’allais dire le plus « immortel », parce qu’il nomme un promontoire dominant l’une des plus belles vallées de l’univers, il participe de toute l’histoire de notre pays, d’avant l’histoire de notre pays, d’avant les temps immémoriaux. Mais aujourd’hui, curieusement, par un revers du destin dont la petite histoire a, seule le secret, les foules agitées, tonitruantes, et superficielles, vont lui tourner le dos pour se précipiter vers l’océan, le livrant et l’abandonnant aux guides, qui abreuveront de connaissances imprécises, des touristes très pressés. Dans ce lieu, j’appris toute l’histoire de mon pays.
Ce promontoire a le nom de Chella. Nos mères l’élisaient, le printemps venu pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions, rythmées aux sons de modestes tambourins, ponctuées par des « yous yous » stridents qui ne dérangeaient nullement les marabouts, gardiens ancestraux (mais moins sourcilleux que les époux) de ce champ de calme et de sérénité qui aiguisait nos sens en éveil comme un flamboyant poème.
La porte monumentale, à la splendeur particulière, à l’apparence ténébreuse, ainsi que les remparts qui semblent enserrer un espace clos, n’intimidaient pas notre impatience à les franchir, parce que nous savions qu’une fois dépassés, ce que nous allions découvrir c’était l’immensité, un vallon lumineux où serpente un fleuve mythique qui fut jadis poissonneux, des vergers que délimitaient des haies d’arbres centenaires, des cactus, des lauriers, des vignes, des orangers et des muriers. Toute une végétation luxuriante dont les parfums embaumant un festival de couleurs. Aucune limite à nos regards éblouis. La cité de l’autre rive dont le nom trouve son origine dans ce nom de Chella, aux multiples déclinaisons, au lieu de perturber par sa présence prétendue hostile cette vision féerique, ne troublait pas l’harmonie du ciel, de l’oued, de l’océan, démentant les supposées inimitié et rivalité de populations jumelles qui alimentaient les salons, d’anecdotes futiles. Harmonie de l’infinitude d’un paysage qui affirmait une réconciliation esthétique, transcendant les vicissitudes anodines de l’histoire.
Les colons l’avaient compris, puisque la colonisation fut aussi synonyme de gourmandise. Un sentier les détournait du chemin de la grande porte, pour descendre vers la vallée, et les menait à un léger promontoire en arrière de Chella : rejoindre un bar ? Un café ? Un restaurant d’où ils pouvaient jouir des délices d’une vue prenante ? Jacques Berque l’affirmait avec justesse dans « Dépossession du monde » lorsqu’il écrivait à propos de l’exploitation coloniale que : « C’est peu que d’exploiter l’Autre, il faut encore le savourer en tant que tel ». Il semblerait, selon les dires des anciens que cet édifice s’appelait ROBINSON. On disait peut-être « Chez ROBINSON ». Je veux bien le croire, parce que tous les auteurs nomment ce chemin parallèle aux remparts mérinides « sentier Robinson ».
Et lorsque, jeunes étudiants, nous demandions au vieux marin de nous faire remonter, pour quelques sous, le cours du fleuve sur sa vieille et peu rassurante barque, il nous demandait si c’était la discrétion du lieu appelé « Robinson » que nos élans affectifs recherchaient pour jouir du plus beau panorama du monde. Mais non. Nous, nous pensions plutôt y retrouver quelque Robinson Crusoé qui aurait savouré, là, une solitude inespérée et un prodigieux silence, propice à la méditation sur les mystères des lieux pétris d’absolue beauté. Nous y lisions l’œuvre de Daniel Defoe, déclamions les poèmes consacrés aux ruines et oubliions les autres jouissances.
Ainsi, serait née une « légende Robinson » qui aurait contribué à enrichir les légendes qui fourmillent dans cet espace « de prédilection pour les légendes ». Mais la gourmandise coloniale fut illégitime, et après des délices éphémères, elle n’enfanta qu’amertume et désolation.
Il faut écouter le murmure de nos mères parce que les légendes qu’elles contaient, à la fin des journées « d’escapades », après les chants, après les visites aux saintes et saints patrons, au cours d’un coucher de soleil fulgurant, elles, étaient des légendes légitimes.
J’appelle ces journées « escapades ». En réalité, elles étaient « fêtes du printemps », dont les origines qui les légitimaient remontaient loin dans l’histoire de ce lieu, aux temps de sa splendeur, que Lissan Eddine Ibn Al-Khatib, bienheureux écrivain et poète, bien malheureux politicien, avait immortalisés. Site vivant et animé par des cérémonies cultuelles que l’histoire transformera de siècle en siècle en agapes annuelles. Le submergeaient des tentes multicolores et les spectateurs nombreux voyaient défiler des musiciens précédés d’étendards pour honorer, pendant un grandiose moussem, les sultans enterrés dans ce jardin sanctifié. Nécropole, disent-ils ? Mais « nécropole vivante ».
Lorsque j’avais proposé à un de mes partenaires lors de la fondation du festival Mawazine, devenu célèbre par la suite, qu’il fallait investir, par des spectacles appropriés, les jardins de Rabat, ville-jardin, il m’avait répondu abruptement, scandalisé, parce que j’y incluais Chella, « il faut laisser les morts aux morts ». L’histoire de ce festival lui donnera tort dès sa première édition. Les chants et musiques sacrées du monde y ont résonné comme de longs échos aux lointaines mélodies émouvantes des musiciens des temps anciens et aux refrains, souvent mélancoliques, des mères des printemps renouvelés. Pour tenter de lever le voile quelque peu sur ce lieu déroutant de mystères, reprenons, sans prétention, Jacques Berque qui, dans sa tentative de lecture de la fête des indépendances, recommande que : « Pour évoquer quelque chose de plus ample, de plus profond, de plus élémentaire que l’historique et le social, risquons même un mot : l’anthropologique ».
Chella comme « ruines » « cimetière » « nécropole » m’a appris deux choses dans la quête de cet anthropologique : d’abord que le bouillonnement des signes qui y affleurent et qui y foisonnent, invite une conscience encore endormie (j’ai mis beaucoup de temps à m’apercevoir que les « escapades » et les « fêtes » de nos familles se déroulaient dans un cimetière), à y « lire », ce que de nos jours des historiens, réinventant Michelet, appellent « le récitnational » et ce que moi, j’appellerai le « roman national » ou la « naissance d’une nation ». La « richesse sémantique » de ce lieu m’a enseigné, de plus, qu’il n’y a point de compréhension de notre présent sans le surgissement du passé le plus reculé de notre histoire, de l’impérieuse et nécessaire réconciliation d’avec nous-mêmes. Chella m’a révélé ce surgissement et m’a aidé à m’engager dans un long parcours à la recherche de cette réconciliation. Ensuite, il m’a appris le pouvoir des légendes, ce qu’elles dérobent à l’histoire réductrice, domestiquée, appauvrissante, et qui est sa saveur, son écume, qui fait perdurer sa quintessence et véhicule dans le murmure pudique de nos mères qui troublait nos émois juvéniles, l’image de sa grandeur et de sa magnificence. Cette saveur, cette écume, cet ornement, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui « patrimoine immatériel ».
Pour cette chronique, je ne retiendrai de ce foisonnement de légendes, ni la diversité qui accompagne le nom lui-même (il serait utile de conseiller l’étude de ces variations à un jeune doctorant en histoire ou en linguistique), ni l’évocation des vestiges de la cité antique qui remontent jusqu’à la période néolithique. J’aurais pu choisir aussi le culte des eaux et des serpents qui pourrait trouver ses origines dans la culture phénicienne ou punique et expliquerait celui des anguilles survivant encore à Chella. J’aurai pu disserter sur les scarabées dorés qui « témoigneraient » disent quelques historiens de la période maurétanienne, mais que personne ne pouvait admirer ni scruter, (faisant partie d’une collection particulière d’un amoureux très discret de ce site). J’aurais pu aussi inviter historiens et archéologues à sortir d’un silence incompréhensible et à réhabiliter justement, cette période maurétanienne, préromaine, encore largement méconnue en étudiant le culte royal dédié aux prestigieux « Rois Maures », en auscultant les monnaies battues à « Sala » (devenue Chella) de cette période, en retraçant à partir des statues qui y avaient été trouvées, la fastueuse histoire de Juba II. Il m’aurait été également possible de revenir sur celle de la non moins fastueuse mais tragique épopée de son fils Ptolémée et de sa femme Cléopâtre Céléné, la fille de la belle, séduisante et sulfureuse Cléopâtre, dernier Pharaon de la dynastie des Lagides, descendante d’un compagnon d’Alexandre le Grand. Cela aurait probablement expliqué pourquoi une princesse égyptienne, la princesse Khadija Riaz - Bey était venue, dans les premières années du protectorat, effectuer des fouilles en compagnie de Jean Borely, directeur de l’administration coloniale des Beaux- arts, afin de rechercher, semble-t-il les origines de la dynastie régnante à l’époque, dans son pays. M. Boujendar, historiographe de Rabat, rapportait, quant à lui, que la légende signalait le passage à Chella, d’Alexandre Le Grand au cours de ses périples conquérants.
La période romaine, dans le récit national est un peu plus connue essentiellement, grâce aux travaux de Jean Boube, et j’aurais donc pu aussi m’attarder sur les assertions de Pline L’Ancien, décrivant la présence en ces lieux d’éléphants et d’hippopotames (les restes d’un squelette de cet animal et une plaque ornementale représentant son profil semble-t-il, pourrait en témoigner), et m’interroger dans cette chronique sur ce qu’étaient les peuplades agressives qu’il nommait « Autotoles ». Je n’ai pas choisi non plus de parler de la période allant du déclin de Chella, conséquence de celui de l’empire romain jusqu’à sa renaissance avec l’arrivée de l’Islam et sa période de troubles, d’invasions, d’instabilité et de destructions. « Siècles obscurs », selon la malheureuse expression de E.F. Gautier, qui n’étaient obscurs que parce que les recherches soumises à une idéologie dominatrice les maintenaient dans l’obscurité, et qui y ont échappé, grâce aux efforts de quelques historiens isolés et passionnés.
J’aurai pu aussi choisir quelques signes liés aux tentatives d’islamisation par les Idrissides des peuples qui, en ces temps y vivaient et dont « Ibn Khaldoun » parle dans « Histoires des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique Septentrionale » (traduction du Baron Slane). Ou relever le fait que Chella soit revenu en héritage à My Omar, un des fils de My Idriss, ou rechercher ceux qui pourraient nous éclairer sur la longue période des Berghouata où Chella figurait en première ligne dans les confrontations meurtrières avec les Idrissides, les Almoravides et les Almohades. J’ai préféré consacrer cette chronique à la mystérieuse stèle funéraire d’Abou Yacoub Youssouf, le Mérinide, source d’une légende la moins connue de toutes, nées en ce lieu privilégié de la dynastie mérinide.
Peut-être, aurais-je mieux fait de privilégier les « Graffitis de Chella », découverts par Jean Campardou et Henri Basset, « un détail bien minime en apparence », écrivent-ils, mais qui offre cependant un certain intérêt. De curieux graffitis se trouvent à l’intérieur de cette porte et représentent d’anciens bateaux dont quelques-uns sont restés en bon état, tandis que beaucoup d’autres ont été dégradés par le vandalisme de visiteurs indélicats. Si l’on suit le conseil de J. Berque, de s’intéresser un peu plus dans ce genre d’études à l’anthropologique, ce détail n’est en effet minime qu’en apparence, parce que, quelque soient ceux qui ont gravé ces graffitis de vaisseaux, leur « distraction esthétique » ou leur «impulsion artistique », témoigne consciemment ou inconsciemment d’une des fabuleuses destinées de ce lieu : avoir été de tous temps un port, et surtout, un port qui fut célèbre. Enserré entre le promontoire des Oudayas et celui du Chella, il avait fait la gloire de valeureux marins qui le rendirent célèbre dans ce qui fut appelé la « Course » des corsaires.
La présence de ces graffitis dans les couloirs de cette porte impressionnante ne peut laisser indifférents ni l’historien, ni l’anthropologue, encore moins l’archéologue, ou le spécialiste du patrimoine immatériel. Je leur confie cette investigation, plus propice à leurs compétences scientifiques qu’à mes spéculations hâtives de chroniqueur.
L’Histoire inachevée de la stèle
Le mystère de cette stèle du sultan Abou Yacoub Youssouf s’est imposé à moi au cours de cette période de confinement comme une évidence. Peut-être, parce que la toxicité de l’ambiance dans notre actualité viciée par le virus de la COVID 19, a nourri l’angoisse, la mélancolie et parfois le désespoir devant une science impuissante à protéger l’humanité ou simplement parce qu’elle a fait ressurgir du fin fond d’une mémoire affaiblie, des souvenirs d’adolescent s’interrogeant sur le bilinguisme de cette curieuse stèle (arabe-latin) délaissée dans ce que les archéologues et les habitués de ce lieu appellent « la Khalwa », et s’étonnant de l’existence de cet orifice de 12 cm, creusé, semble-t-il, ultérieurement. Par qui ? Pourquoi ? (Avant qu’elle ne soit intelligemment exposée dans le Musée archéologique de Rabat que mon ami Mehdi Qotbi a si judicieusement restauré). Peut-être aussi, parce que, plongé au cours de ces longues journées et longues nuits d’isolement et de distanciation sociaux, dans une relecture du « roman national » et de l’épopée de l’édification de la nation « MAROC », je pistai dans ce lent et passionnant itinéraire, les différents aspects d’un « patrimoine immatériel », qui pourrait un jour constituer un levier de développement local et surtout national. Mais c’est surtout, une affirmation de Marc Terrisse dans son étude « Les Musées de sites archéologiques en tant que vecteurs de développement local… », qui m’a persuadé d’entreprendre cette modeste investigation : « Chella demeure dans ce contexte une nouvelle fois un excellent témoignage de cette histoire culturelle métissée et plurielle forte d’influences multiples ». N’est-ce pas là une correspondance heureuse avec la définition que donne le préambule de la constitution de 2011, de l’unité de notre identité, « forgée par la convergence de ses composantes…, nourrie et enrichie de ses divers affluents ? ». Correspondance qui encourage à aller plus avant dans le dévoilement des fondements de cette unité à travers le divers, et à affirmer en se référant encore une fois aux intuitions de Jacques Berque, que : « La situation reste douloureuse et confuse tant que l’homme - individus ou peuples - ne parvient pas à l’unité véritable, c’est-à-dire à l’exaltation unitaire de traits distinctifs ». Chella est la preuve concrète de cette unité forgée par une histoire douloureuse, et le préambule de la constitution de 2011 est l’exemple exceptionnel dans cette histoire de l’exaltation unitaire « des traits distinctifs … » de notre identité.
Que Chella soit ce lieu gavé d’histoire qui illustre admirablement « l’anthropologique », si cher à Jacques Berque, légitime amplement l’étude de cette trace mystérieuse que représente une stèle qu’aucune investigation convaincante n’est arrivée à cerner dans la symbolique de ses représentations. Cette chronique n’est que la propédeutique à un travail de recherche plus approfondi dans ce qui est appelé « l’histoire longue » et qui, je l’espère, sera entrepris par des historiens plus compétents et plus doués dans une discipline qui n’est pas la mienne.
Néanmoins, dans cette chronique, ne sont exposés que des interrogations que suscite cette stèle, que ne dissipe en rien la documentation bien imprécise, bien contradictoire dont peut disposer le chercheur. A moins que des recherches en cours, s’il y en a, viennent un jour éclairer les zones d’ombre qu’elle véhicule et parviennent à élucider le sens de la légende qui l’enveloppe.
Il m’a semblé, dans mes lectures des rares traces qui la concernaient, dans les multiples études sur Chella, nécropole mérinide, (qui m’aidèrent à vaincre le détestable ennui généré par le confinement), qu’elle fut soit négligée par leurs auteurs, en particulier par ceux qui se sont intéressés à l’épigraphie historique des lieux, soit qu’ils n’en n’eurent pas connaissance au moment de leurs investigations et qu’elle ne soit réapparue, curieusement, qu’à un moment où personne ne pouvait lui accorder une signification quelconque. Au moment probablement où les fouilles dans ce lieu ont connu et connaissent encore une interruption regrettable.
Ce qui va nous intéresser, ici, ce n’est pas la biographie d’un des premiers sultans de la dynastie mérinide et le deuxième à être enterré à Chella, mais le surgissement des questions sans réponses que l’étrangeté de cette stèle suscite et la persistance de la légende qui l’accompagne, légende que l’on a assimilée à de la superstition et que son transfert au musée archéologique, alimente encore plus d’étrangeté au lieu d’en tarir les sens, résistant ainsi à sa banalisation alors qu’une des significations, au moins, est d’une portée éthique d’une étonnante actualité.
Elle est, si l’on peut dire dense de significations. Nous ne nous attarderons pas sur le débat, certes intellectuellement et historiquement nécessaire, qui s’était instauré sur la localisation exacte de la tombe du sultan Abou Yacoub Youssouf dans la nécropole et que semble avoir clos Othmane Othmane Ismael dans son importante étude sur « l’histoire de la Chella islamique ». Nous nous attacherons plutôt à cerner les questions qui se posent aux visiteurs des tombes ou à ceux du musée archéologique qui expose cette étrange « trace » à l’étonnement du public, s’il est attentif, à son indifférence s’il est pressé. Nous procèderons si possible à un « abornement » de ces interrogations qui s’effectuera en deux temps. Le premier concerne « l’anthropologique » que nous avons déjà évoqué, le second privilégiera une « archéologie d’un imaginaire » affectif à portée éthique ou morale.
S’impose sans conteste dans la première approche, la question suivante : l’usage des stèles funéraires, que les Mérinides ont pratiqué avec beaucoup d’élégance est-il une tradition dans l’Islam ? Il semblerait que non, et dans ce cas, tenter de répondre à cette première interrogation dépasserait le cadre de cette chronique. La seconde question serait : où cette stèle a-t-elle été « fabriquée » une fois le choix de cette base romaine effectué ? Romaine, parce qu’il y a une inscription latine sur un versant de la stèle ? Mais alors où cette base a-t-elle été trouvée ? A Chella, où dans les ruines autour de Tlemcen puisque ce sultan est mort à la « Mansouria », la ville qu’il a bâtie dans cette région, proche elle aussi des ruines romaines, ou provient-elle d’Espagne «Andalousie» (ancienne Bétique romaine) puisqu’elle porte le nom d’un certain Aulus Caecina Tacitus, que les spécialistes n’arrivent ni à identifier ni à situer et qui fut probablement gouverneur de la Bétique romaine, certainement comme le précise le texte latin « briguant la charge de Préteur, de Questeur…… ».
Une base est la partie inférieure sur laquelle repose un piédestal, ou un buste ou tout autre objet comme une colonne par exemple. C’est donc un socle, un soubassement une assise ou un appui. Le mystère s’épaissit quand on arrive difficilement à comprendre pourquoi, au lieu de choisir une plaque de marbre blanc vierge, ceux qui ont « fabriqué » cette stèle, ont privilégié une base romaine déjà utilisée, gravée pour un obscur gouverneur romain, alors qu’elle devait être dédiée à la gloire et à la mémoire d’un sultan connu ?
Quand on s’engage plus avant dans l’étude de l’histoire énigmatique de cette stèle on apprend qu’elle fut trouvée en 1881, sans préciser ni par qui, ni comment, ni à quelle occasion et qu’elle été retrouvée en 1926, écrit L. Chatelain « dans le jardin de S.M le Sultan » (je suppose que ce sultan était le Sultan MY Youssouf), (curieuse coïncidence puisqu’y figure aussi le nom de Youssouf).
Lévy Provençal et Henri Basset signalent dans leur étude sur Chella, qu’il y a une stèle où figure le nom d’Abou l- Hassan, qui ne serait pas sa propre épitaphe, qui mentionne le palais de « el – Mansoura » de Tlemcen La Neuve et que « étant donné que, le seul Sultan Mérinide mort à el-Mansoura et enterré à Chella, est précisément le fondateur de cette ville , Abou Yacoub Youssouf, « que cette stèle soit celle de ce souverain, qui au vu des témoignages d’historiens arabes, fut transporté à Chella pour y être enterré ». Ce n’est donc pas cette stèle « bilingue » qui nous intéresse et que ces deux auteurs n’ont pas connue « puisqu’ils nous disent qu’il existe à Chella, depuis quelques années, une pierre portant l’épitaphe d’Abou Yacoub ». Or, elle a disparu depuis. Peut-être est-ce, précisément celle qui, au dire du Moquadem de Sidi Iahia, fut emportée en dehors du Maroc. Il serait du plus haut intérêt de savoir quel endroit abrite cette inscription qu’il faut jusqu’à nouvel ordre considérée comme PERDUE. Le texte, fort heureusement en a été conservé, grâce à un calque rapporté au British Muséum par le vice-consul anglais Frost et a été traduit par « Tissot ». Il s’agit de la reproduction parfaite de l’épitaphe qui nous intéresse, mais les deux auteurs ignoraient l’existence de l’inscription latine, qui n’a pas attiré l’attention du vice-consul anglais, or, tout porte à croire que c’est cette même stèle qui aurait, à une certaine époque, fait partie des collections du musée britannique.
Il y aurait donc deux stèles et deux épitaphes concernant Abou Yacoub Youssouf ?????
La stèle qui nous intéresse aurait disparu en 1881, réapparue en 1926, re - disparue, réapparue pour enfin atterrir avec tous ses mystères « anthropologiques » dans le Musée archéologique de Rabat. On dit, à son sujet, qu’elle aurait été utilisée par Pierre Loti, (dont l’ouvrage AU MAROC marqua le début de l’exotisme littéraire marocain) afin de décorer son domicile. Cette stèle aurait fait partie des nombreux objets ramenés de son voyage, alors qu’il était accompagné par l’ambassadeur Patenôtre en 1890.
Date qui ne correspond pas à la période de la disparition de la stèle et qui interdit de penser, qu’effectivement, elle aurait pu avoir été transportée dans les bagages de cet auteur. Un début de « légende » qui nous interdit de faire d’un auteur célèbre à l’époque et amateur de ruines, un resquilleur de ruines.
Pour essayer de cerner le « bilinguisme » inexplicable de cette stèle qu’illustre le versant arabe et le versant latin de la réutilisation mystérieuse d’une base romaine, (qui ne représente aucun intérêt majeur historiquement), osons une interprétation dans une réécriture légitime du récit national en l’empruntant à Antoine Pietrobelli qui parle du choix de ce lieu « comme lieu privilégié des sépultures de sultans mérinides ». Est-il permis de penser que ces rois placent EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, leur nécropole en contrebas du Capitole et du centre antique soit comme un HOMMAGE AUX ANCIENS, soit comme une volonté d’islamiser un lieu ? Cette « lecture » expliquerait le choix « en toute connaissance de cause » d’une base dont le versant porte une inscription latine quelle que soit l’importance ou l’insignifiance de son contenu. L’Islamisation du lieu n’écarte nullement « l’hommage aux anciens ». La proximité des ruines romaines n’a, en rien, gêné ceux qui ont décidé de fonder une nécropole, en particulier le sultan Abou Youssouf Yacoub. Nous savons que ces sultans étaient instruits et pieux. Que l’urbanisme de leurs médersas et l’art qu’on y admire témoigneraient d’une sensibilité à la durée, à une conscience perceptible de la postérité, et avec, le voisinage des ruines romaines, montrerait surtout une « acceptation » notable de l’histoire qui les a précédés.
Au bout de la légende
La légende s’est emparée de cette stèle, de même qu’elle s’est emparée de tout ce lieu depuis des temps immémoriaux, au point que l’on peut affirmer que Chella est une « fabrique » de légendes. Pour les auteurs, historiens et écrivains-poètes, il fut prédestiné aux légendes. Celle qui accompagne cette stèle n’est pas connue, n’est pas non plus citée dans la série de toutes les légendes qui ont été répertoriées. Néanmoins, elle est omniprésente dans la mémoire des habitants de Rabat et le fut surtout dans celle des anciens.
Pour notre génération elle commençait par diffuser de l’inquiétude qui se transformait en terreur pour finir en éclats de rire et en un fébrile soulagement qui ne se débarrassait de l’appréhension persistante que longtemps après notre visite à Chella. La légende la plus connue est celle des anguilles « sacrées », qui remonte probablement jusqu’aux temps du paganisme des premières populations et des croyances les plus reculées. On ne s’y attardera pas. Tout le monde sait que les femmes stériles y venaient, persuadées que nourrir ces anguilles, leur offrirait la fertilité. Il y a la légende du « Sultan noir », protecteur des lieux et qui peut être identifié comme étant le Sultan Abou l’Hassan, le plus fastueux des sultans mérinides. Celle de la destruction de la ville qui reprend une légende que l’on retrouve dans d’autres civilisations comme la destruction, pour ses péchés, de la ville d’Ys. Edmond Pauty relate ce conte ainsi : « On raconte que les cailloux qui roulent sur les capricieux sentiers de Chella ne sont autres que les yeux, le nez ou les bouches d’anciens habitants qui maculèrent avec une impiété impardonnable, le blé ou autres céréales qu’ils possédaient en abondance. Quel impressionnant conte que celui de ce savant alchimiste possédant le secret de la fabrication de l’or qui lui fut ravi adroitement par le sultan !!!
Pour se venger, il diffusa son secret dans toute la ville ; ainsi les habitants moururent sur les monceaux du précieux métal.
L’imagination populaire a compté plusieurs versions de cette histoire... »
Il y a aussi la légende de l’anneau de Salomon, enfoui quelque part dans cette cité, qui n’hésite pas à suggérer que c’est Salomon lui-même qui l’aurait fondée. Génies et trésors étant souvent liés, la naïveté populaire a cru que Chella dissimulait d’innombrables trésors que des chercheurs imprudents se seraient hasardés à découvrir. La légende nous dit que par la suite, les chercheurs ont bien mystérieusement disparus.
De cette profusion de légendes, les sultans deviennent des saints comme My Yacoub, qui serait probablement l’Abou Yacoub de notre stèle et Lalla Chella qui serait Chems Doha, l’épouse du sultan Abou l-Hassan. Au cours de leurs « escapades », nos mères recherchaient dévotement pour elles, leur bénédiction, et pour nous, leurs protections.
Je n’évoquerai que deux autres pieuses légendes parmi tant d’autres qui pouvaient faire d’un « voleur » un saint et d’une fille quelque peu « dévergondée » une sainte.
L’une d’entre elle, qui, à mon sens est particulièrement émouvante et touchante, concerne la participation des plus démunis aux circonvolutions autour de la Kaaba. Il se trouve que dans la partie que l’on assimile à une zaouiya, le mihrab dissimulait un couloir en coude et si l’on tournait sept fois autour du mihrab, le jour de ARAFAT, c’est comme si l’on avait accompli entièrement le pèlerinage.
L’autre concerne le petit mausolée vénéré de Sidi Yahia, proche du bassin aux anguilles. Curieux ce Sidi Yahia, qu’on dit être Jean le Baptiste (Ibn Khaldoun n’affirma-t-il pas que des chrétiens habitaient encore Chella au temps des Idrissides ?), mais surtout qu’on prétend être un saint homme ayant conversé avec un prophète, des décennies avant la révélation et la prophétie.
La légende qui se rapproche le mieux de celle qui enveloppe la stèle qui nous intéresse c’est celle qu’Edmond Pauty, précédemment cité, relate, et qui a rapport avec l’irrespectueuse attitude que l’on peut avoir envers les anguilles et les tortues. « Il ne faudrait pas suspecter leur autorité, écrit-il, on en ressentirait aux jointures de violentes douleurs. Certains eurent même les pieds et les mains paralysés en représailles de leur effronterie ».
Il s’agira, en effet, de violentes douleurs et de paralysie surtout des mains dans la légende de la stèle d’Abou Yacoub Youssouf. Cette stèle présente un trou, un orifice, au milieu du côté droit, de 12 cm de diamètre. Comment cet orifice avait-il été réalisé avec cette précision remarquable, sur cette stèle en particulier ? J’ai, pendant mes recherches auprès des historiens de Chella, essayé de trouver une explication, en vain. Un connaisseur du site avait suggéré, sans grande conviction, qu’elle pouvait être d’origine hydraulique. S’il n’existe aucune explication « historique », la légende va l’utiliser et cette utilisation accentuera le mystère. Que dit cette légende ? Que si une personne maudite par ses parents pour une action d’impiété ou de mauvaise conduite, introduit volontairement, par jeu ou par mégarde, sa main dans l’orifice, elle ressentirait des douleurs insupportables, voire une paralysie. Il ne pourrait la ressortir ni se dégager ni se libérer de l’étau qui l’enserre et, s’il y arrive, ce n’est qu’après d’épuisants efforts. Imaginez le jeu que la jeunesse rbatie, impitoyable, parce que toute jeunesse l’est un moment ou un autre et ce qu’elle a inventé à partir de cette légende. Imaginez un groupe d’adolescents, les jours « d’escapades », s’éloignant des tentes et des réjouissances familiales, se hasardant dans la nécropole, figés devant cette stèle et son orifice, se lançant des regards de défis silencieux, sans qu’aucun d’entre eux n’ait le courage d’entreprendre, le premier, cette expérience peu tentante. Après maintes hésitations, il y en avait toujours un qui se hasardait, certain d’être béni par ses parents, pour s’armer d’une certaine d’audace et qui finissait par réussir là où beaucoup craignaient (ayant commis quelque indélicatesse) d’échouer et de rester prisonnier de leur faute et des génies des lieux. Devant son succès, ses camarades n’hésitaient plus à relever son défi à lui, non celui que représente l’orifice de la stèle. C’était alors un défilé de fanfaronnades, une multitude de soupirs bruyants et tonitruants de soulagement. Toutefois, il y avait toujours, l’un d’entre eux, le plus effacé, le plus timide, le plus effrayé, qui, manquant de courage, renonçait à relever le défi. Objet de sarcasmes, de sourires sardoniques, il n’avait pas le choix et devait, pour échapper aux moqueries de ses camarades, affronter l’orifice. Il fallait qu’il leur prouve qu’il n’était ni la cause ni la raison de sa frayeur, mais la faute, jusque-là inavouée, d’avoir désobéi à ses parents. Son refus, son hésitation, son manque de hardiesse, représentaient à leurs yeux l’aveu public qu’il était un mauvais fils, que Dieu et ses parents avaient maudit. Il ne pouvait se soustraire à cette périlleuse expérience, devait la réussir pour ne pas être banni du groupe, et pour ne pas connaître les affres du bannissement, aussi bien à l’école que dans son quartier. Cette expérience devenait, en quelque sorte, un rite initiatique. Le sort de celui qui ne le réussissait pas (mais tous ceux qui s’y soumettaient, bien évidemment, le réussissaient), était de subir une effroyable exclusion. Une inévitable condamnation à la solitude attendait surtout celui qui s’y refusait et lâche, s’enfuyait, honteux. Au moment où le groupe était sur le point de se disperser, il osait alors introduire sa main et sentait soudain comme des douleurs l’irriguer, et qu’une curieuse paralysie s’en emparait. Il se mettait à hurler, persuadé que sa main allait rester prisonnière de cette stèle devenue « maléfique ». Ce n’était pas la solitude du quartier qui serait son destin mais une solitude éternelle, dans l’éternité des ruines. Il luttait contre la stèle et son orifice. Maladroit et toujours honteux, il arrivait, bien évidemment à se libérer. Pour tout le groupe hilare, il venait de réussir. Lui, ne comprenait pas cette mystérieuse paralysie, surgie du fin fond d’un moi torturé. Le groupe ignorait qu’il était orphelin. Nul ne pouvait l’assurer, dans la solitude de son état, si son père l’avait béni ou maudit avant de l’abandonner et de le laisser, démuni devant les incertitudes d’un destin cruellement injuste dès les premières années de sa triste enfance.
Il me raconta cette aventure de la stèle, m’a confié qu’il s’était adressé un jour à un psychanalyste pour comprendre cette horrible sensation de « paralysie » qui a failli l’anéantir et le ridiculiser devant ses amis. La science de Freud fut cependant impuissante à élucider pourquoi, en ce qui le concerne, la légende a failli avoir raison et n’être plus simple légende.
Comment naissent les légendes semblables à celles qui foisonnent à Chella ? En particulier celles, porteuses de sens moral, comme l’obéissance aux parents, le respect qui leur est dû, la malédiction qui s’abattrait inévitablement, un jour, sur tous ceux qui se révolteraient contre eux, les vexeraient, les oublieraient quand ils seraient vieux, les abandonneraient aux douleurs, souffrances, à la solitude, à leur faiblesse, à leur « impuissance », à leur « paralysie » devant les inconforts, les incertitudes et malheurs d’une fin de vie. Question probablement sans réponse. J’en avancerai malgré tout une, concernant la mystérieuse stèle de AbouYacoub Youssouf. Les légendes ne naissent pas d’évènements mineurs. Les historiens savent que celle-ci trouvera surement l’élucidation de son mystère dans les conflits et les péripéties qui ont jalonné l’épopée mérinide. Elle expliquera certainement, pourquoi celui ou ceux qui ont choisi les textes qui figurent sur la stèle, (un sultan ?) ont choisi les versets de la sourate Loqmane :
يأيها النـــاس اتقــوا ربكم واخشــوا يـوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جـازعن والــده شيئا
« Hommes ! Craignez votre seigneur et redoutez un jour ou le père ne répondra en quoi que ce se soit pour son enfant, ni l’enfant pour son père … ». C’est la traduction que le Musée d’Archéologie de Rabat propose sans donner le nom du traducteur du verset …
Denise Masson, en propose une autre :
« O vous, les hommes
Craignez votre seigneur !
Redoutez un Jour,
Où un père ne pourra pas satisfaire pour son fils,
Ni un enfant satisfaire pour son père ».
La sourate XXXI est essentiellement consacrée aux conseils que donne le sage Loqmane à son fils, et ces conseils ont essentiellement pour axe le respect dû aux parents. Le verset élu, pour figurer dans le listel de la stèle qui nous intéresse, insiste sur l’impossible intercession du père pour son fils et celle du fils pour son père le Jour qu’ils doivent craindre (que je suppose être le Jour du jugement dernier).
Le choix de la sourate et de ce verset en particulier n’est pas un hasard. Il a dû se passer, dans la tumultueuse histoire des Mérinides, un évènement grave qui le légitimerait. Un parricide ?
Nous laisserons les historiens nous éclairer sur ces éléments d’analyse. Ce qui a retenu mon attention, c’est que la légende n’allait s’emparer que du premier segment du verset : « Redoutez le jour où un père ne pourra pas satisfaire pour son fils... » … « le jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son fils... ». Elle fera de la malédiction du père le fondement du mythe colporté par l’orifice de la stèle et la base du jeu des adolescents en mal de sensations fortes et d’aventures périlleuses. La légende aurait donc une justification anthropologique. Toutefois, la stèle gardera encore et pour longtemps ses mystères et ses zones d’ombre.
« Et l’œil dans la tombe regardait Caen (Victor Hugo). L’orifice vide de la stèle regorgeait de sens pour les jeunes adolescents, quand elle faisait encore partie de son élément naturel, intriguait les touristes dans leur visite pressée de ce petit bout de terre qu’est le Chella, microcosme où se condense toute l’histoire du Maroc.
C’est cette condensation qui a motivé Marc Terrisse et l’a encouragé à produire la thèse séduisante d’un musée à ciel ouvert pour le Chella. En ce moment, où une volonté réelle apparait chez les décideurs pour faire du patrimoine immatériel, un des leviers majeurs du développement économique, social et culturel du pays, la lecture de l’étude remarquable de ce chercheur, en particulier de la troisième partie : « Tentative d’interprétation du site de Chella », est plus qu’opportune. Elle est nécessaire et indispensable. Mais les « experts » en sites et en « patrimoine culturel, lisent-ils ?
« Chella, écrit ce chercheur, peut ainsi paraitre comme un vecteur de compréhension pour les scientifiques et le grand public de la civilisation antique marocaine et ses multiples évolutions et permanences sur le temps long ».
On peut aussi appliquer à ce site ce qu’il dit de la ville de Rabat elle-même: « C’est d’ailleurs l’UNIQUE, grande ville marocaine qui abrite à la fois des vestiges antiques, des monuments attestant de la grandeur et des raffinements des sultans Almohades ou Mérinides, des édifices d’envergure érigés …. ». J’ajoute, depuis le début du siècle et en particulier depuis l’avènement du Roi Mohammed VI. « Rabat, et par conséquent Chella conservent » précise- t-il « une pléiade de témoignages se rapportant à toute l’histoire du Maroc et des civilisations qui ont façonnés son histoire et sa culture au fil des siècles ».
En attendant, Chella et ses légendes distraient quelques amoureux des ruines, et quelques rbatis nostalgiques des temps heureux des « escapades ».
J’ai, quant à moi, au cours de ce long et pénible confinement, fait un voyage autour de cette mystérieuse stèle du sultan Abu Yacoub Youssouf le mérinide, comme De Maistre avait fait un voyage autour de sa chambre, et j’ai beaucoup appris, grâce à cette passionnante investigation, sur la prodigieuse « naissance d’une nation », la nôtre.
Je ne voudrai pas terminer cette chronique sans lancer un appel (qui n’a rien à voir ou peut-être que si ..., qui a à voir, puisqu’il concerne indirectement Chella) que voici : Mes recherches m’ont appris que le peintre Gherbaoui, un des peintres parmi les peintres les plus célèbres des premiers temps de la peinture au Maroc, a habité, toute une année, une petite maison à Chella. Je ne possède pas plus d’informations. Je serai reconnaissant, au lecteur, au connaisseur de l’œuvre de Gherbaoui, à l’amoureux de Chella, à l’artiste, au collectionneur, au directeur de musée, à l’administrateur de la culture, au « spécialiste » du tourisme, au responsable d’un des conseils locaux ou régionaux de la ville, s’il a une information sur ce mystérieux séjour de Gharbaoui dans Chella, qu’il ait l’amabilité de m’en faire part ou tout simplement de la confirmer pour la postérité. Si ce miracle advenait, je n’aurais pas perdu mon temps à éclaircir les mystères d’une si étonnante stèle.
Et mon confinement n’aurait pas été vain.